
José Ortega y Gasset philosophe de l’Histoire
par Charles Cascalès, agrégé de philosophie,
auteur de ‘L’humanisme d’Ortega y Gasset’, PUF,1957
_________________
INTRODUCTION
| Nous nous proposons d'exposer dans cette étude la philosophie de l'histoire d'Ortega y Gasset, le plus important des philosophes espagnols contemporains. Né à Madrid en 1883, José Ortega y Gasset poursuit ses études de philosophie dans les universités allemandes de Leipzig, Berlin et Marbourg. Il est professeur de philosophie à l'université de Madrid de 1910 à 1936, puis à l'étranger jusqu'en 1946. Journaliste (son père dirige El Imparcial, grand quotidien de gauche), Ortega fonde en 1915 la revue España, avec Azorin et Eugenio D' Ors, et en 1923 la Revista de Occidente qui paraîtra jusqu'en juillet 1936, pour revoir le jour en 1961. En 1931, Ortega est député de la province de Leon aux Cortes de la République, mais il se retire progressivement de la vie politique jusqu'à son exil en août 1936 à la suite du soulèvement de Franco. Il meurt en octobre 1955 à Madrid.
Il faut savoir, en effet, que les concepts déterminants de la phénoménologie heiddeggérienne préexistent parfois avec une antériorité de treize ans dans les écrits d'Ortega. Par exemple, l'idée de la vie comme inquiétude, préoccupation et insécurité, et de la culture comme sécurité et préoccupation de la sécurité se trouve dans les Meditaciones del Quijote, dès 1914. C'est aussi le cas pour la critique du substantialisme, pour la définition de la vie comme "dialogue dynamique entre l'individu et le monde", ainsi que pour l'interprétation de la vérité comme " dévoilement ". On pourrait donc situer la philosophie d'Ortega à côté de celles de Bergson et de Heidegger, en voyant en elles trois tentatives pour prolonger la réflexion critique de Kant chez qui, selon notre auteur, "sont contenus les secrets décisifs de l'époque moderne, ses vertus et ses défauts." |
I- La philosophie d'Ortega y Grasset
| L'orientation philosophique d'Ortega est définie dès 1923, dans son livre El tema de nuestro tiempo, comme ratiovitalisme : la tâche de la philosophie est désormais de transformer la raison pure en raison vitale.
a) Idées et croyances Sous le titre Ideas y Creencias (1940), Ortega a publié ce qui devait être le premier chapitre d'un ouvrage plus vaste, Aurore de la raison historique, et où il esquisse la conception du savoir qui sous-tend sa réflexion philosophique. Il y distingue fondamentalement les idées-occurrences, idées que conçoit un individu déterminé, et les idées-croyances, lesquelles, loin de venir à l'esprit de cet individu, représentent pour lui la réalité même. Les premières apparaissent comme de simples pensées; les secondes possèdent tous les caractères de la réalité. À notre insu, nous vivons avec de telles croyances qui fondent véritablement notre penser, notre agir, notre sentir. Nous concevons ou produisons les idées ; mais ce sont les croyances qui opèrent en nous: "ce ne sont pas des idées que nous avons, mais des idées que nous sommes. "Les croyances ont d'ailleurs une vie propre et passent par trois stades successifs: foi vivante, foi inerte ou morte, doute (1). Le doute appartient en effet à la même région de notre être que la croyance: il est une façon déficiente de croire, mais il n'est pas une absence de croyance. Au contraire, nous sommes dans le doute quand deux croyances incompatibles s'opposent en nous.
"Aucun monde n'est donné tout fait à l'homme. Seules lui sont offertes les peines et les joies de la vie. C'est sous leur conduite qu'il doit inventer le monde. La majeure partie de ce dernier, il l'a héritée de ses aînés et c'est elle qui agit sur la vie comme un système de croyances solidement établies. Mais chacun doit s'expliquer pour son propre compte avec tout ce qui est douteux, tout ce qui est en question. C'est à cette fin qu'il essaye des figures imaginaires de mondes et s'enquiert de sa conduite possible en eux. Parmi elles, l'une lui semble idéalement plus consistante et c'est ce qu'il appelle la vérité. Mais il n'en demeure pas moins que le vrai, et même ce qui est scientifiquement vérifié n'est qu'un cas particulier du fantastique. Il est des fantaisies exactes. Qui plus est : seul ce qui est fantastique peut être exact. Il n'y a pas moyen de bien comprendre l'homme si l'on ne remarque pas que la mathématique jaillit de la même source que la poésie, le don d'imaginer." |
· b) La pensée humaine.
En fait, " est pensée tout ce que nous faisons pour sortir du doute dans lequel nous sommes tombés et parvenir de nouveau à être dans la certitude". Mais les formes revêtues par la pensée sont toutes datées : elles sont autant de façons différentes de chercher à savoir à quoi s'en tenir sur le monde. L'évolution de la théorie déductive (1947, traduction française 1970) développe le tableau de ces méthodes ou chemins de la Pensée, en distinguant, à côté de la superstition qui représente l'absence d'interprétation d'ensemble de la réalité et ne traduit que la stupéfaction de l'homme, la magie qui est une interprétation non-explicative ou pratique, et le mythe qui est la première interprétation explicative du monde par l'homme. Le mythe n'est pas un genre littéraire : " il est une méthode intellectuelle qui "forme" le Monde dans lequel un peuple vit durant des millénaires. " Le propre de cette méthode est de consister en une pure invention fantastique provoquée par un phénomène exceptionnel, un événement faisant naître une émotion : Ce qu'il y a de commun à la religion, au mythe et à la poésie (celle d'Homère, par exemple), c'est d'être des interprétations purement imaginaires.
Au contraire, philosophie et science dessinent une orientation ultérieure de cette "fonction essentielle de la vie qu'est l'interprétation de l'univers." Ce n'est plus une modalité émotionnelle et imaginaire mais sensorielle et conceptuelle de la pensée. Et ces activités, religion, mythe, poésie, philosophie, science ne représentent pas des possibilités permanentes de la nature humaine : elles constituent "une succession inexorable que l'homme traverse à des dates déterminées", car il n'y a pas de nature humaine. La pluralité des cultures et l'irréversibilité de leur déploiement sont irréductibles : c'est l'homme même qui change, qui se change, qui se crée lui-même.
Ainsi la théorie des croyances, en identifiant dans l'ontologie une interprétation déterminée et singulière de la réalité comme ' être intelligible ", débouche dans une théorie de la vie qui ne prendra elle-même toute sa stature qu'avec la théorie de l'histoire.
· B) La théorie de la vie
a) Déconstruction de l'ontologie. C'est dans un texte de 1929, Filosofia pura, qu'Ortega aborde explicitement la question ontologique pour en souligner l'équivocité foncière. D'un côté, la question : " Qu'est-ce que l'être ?" invite à chercher l'identité de l'être, elle demande à quel genre d'objets correspond un tel prédicat. Et de Thalès à Kant, les réponses se succèdent. Parmi elles, l'idéalisme revient à soutenir que la pensée est l'étant, est la "chose" à laquelle appartient authentiquement le prédicat "être " . Mais, d'un autre côté, la question de l'être consiste à se demander ce qu'est être, quel que soit l'être dont on dit qu'il est. Cette seconde interrogation a toujours été oblitérée par les réponses faites à la première : l'être (quel qu'il soit) est toujours sous-entendu comme chose, réalité, en-soi. La question de l'être, dans son second sens a donc toujours été implicitement résolue dans toute l'histoire de la philosophie d'une seule et même façon. Du moins jusqu'à Kant : mais ce que l'on a méconnu chez Kant, c'est qu'il répond d'une autre façon. En effet, l'ambiguïté de la question ontologique se répercute au niveau de la réponse qu'on y apporte. Kant dit bien que l'être est pensée, mais il récuse la dénomination d'idéalisme, comme chacun sait. L'être des choses est ce que nous y mettons : "Ies conditions de possibilité de l'expérience sont les mêmes que les conditions de la possibilité des objets de l'expérience. " L'être est ce qui survient aux choses quand un sujet pensant entre en relation avec elles. "C'est le sujet qui pose l'être dans l'univers ; sans sujet, il n'y a pas d'être", écrit Ortega. Sans sujet pensant, il n'y a pas plus d'être des choses que d'égalité entre elles, par exemple. " L'être ou le non-être des choses jaillit de leur choc avec l'activité théorétique en général . "
Kant effectue donc un saut : l'être de l'étant n'est plus défini comme en-soi ; l'être est conçu comme pour-autrui "l'être est un pour-autrui, et avant tout un pour-moi". Et Ortega poursuit :
"Ainsi chez Kant, pour la première fois -à l'exception des Sophistes- il apparaît impossible de parler de l'être sans chercher auparavant ce qu'il en est du sujet connaissant, puisque ce dernier intervient dans la constitution de l'être des "choses", puisque les " choses " sont ou ne sont pas en fonction de lui "
b) Le concept de réalité radicale
La conception ortéguienne de la réalité ne doit donc pas être dénommée une ontologie, mais une théorie de la vie faisant apparaître la vie comme réalité radicale et en entendant par "vie humaine" la vie de chacun, ma vie. Dès 1914, Ortega écrit "Je suis moi et ma circonstance", et il commente cette formule en disant "La réalité radicale est notre vie. Et la vie est ce que nous faisons et ce qui nous arrive. Vivre, c'est être en rapport avec le monde, se tourner vers lui, agir sur lui, s'occuper de lui " Mais il faut préciser qu'en dénommant la vie de chacun "réalité radicale", Ortega ne veut pas dire qu'elle soit l'unique réalité ni même la plus haute, mais simplement qu'elle est la racine de toutes les autres, en ce sens que celles-ci quelles qu'elles soient, doivent pour nous apparaître comme réalités se présenter ou s'annoncer dans les limites de notre vie.
L'être est donc un horizon dont le centre est l'individu. La circonstance n'est d'abord qu'un entourage composé de pures énigmes et qui ne prend figure de monde qu'à travers une interprétation déterminée. Dans El Hombre y la gente (1949), Ortega précise ce qu'il appelle les " lois structurales " du monde qui définissent non les choses qu'il y a dans notre monde, mais la forme permanente de ce dernier, son, anatomie, en quelque sorte. On peut résumer cette description, proche de la phénoménologie de Husserl, en retenant les points suivants : à chaque instant, le monde se compose de présences et de co-présences, de choses manifestes et de choses latentes ; une chose ne nous -est jamais donnée seule, mais nous la percevons toujours sur le fond de ce à quoi nous ne prêtons pas attention ; la corporéité humaine m'interdit l'ubiquité et m'ouvre le monde comme une perspective, moi, mon corps et ici coïncidant toujours comme point de vue irréductible ; ce point de vue n'est pourtant pas celui d'un spectateur, les choses étant d'abord réparties en "champs pragmatiques" ou "champs de sujets de préoccupation", puisqu'elles ne sont originellement que de pures énigmes.
Si nous passons à Présent de la structure du monde à son contenu, nous y découvrons également une hétérogénéité foncière, celle qu'enregistre la tradition en distinguant banalement la pierre, la plante, l'animal et l'homme. Phénoménologiquement, ce qui différencie le minéral de l'animal est évident: si la pierre que je lance existe pour moi, en revanche, je n'existe pas pour elle, tandis que non seulement l'animal existe pour moi, mais j'existe aussi pour lui, et c'est de cette réciprocité que je tiens compte, dans mes rapports avec lui, en fonction de l'espèce à laquelle il appartient. C'est cette coexistence que nous retrouvons dans le rapport social que les hommes nouent entre eux. Et Ortega formule ainsi ce qu'il appelle un premier théorème social : "Avant que chacun de nous eût pris conscience de lui-même, il avait déjà fait l'expérience fondamentale qu'il y a ceux qui ne sont pas "moi", les Autres".
C'est cette ouverture à l'autre, cet altruisme fondamental (2) qui fait de notre vie une vie partagée, une "vie en dialogue" disait Martin Buber, une "covivance" (convivencia) comme le dit Ortega, une convivialité, si l'on préfère. Et de même que la corporéité ordonne le monde en perspective, la convivialité fait
du monde une réalité objective: c'est l'altérité d'Autrui qui se projette sur le monde qui nous est commun ; le dit monde objectif, qui est celui de tous les humains en tant qu'ils forment une société, est le corrélat de celle-ci et finalement de l'humanité entière. La conséquence est que le monde objectif ne peut pas être composé de choses qui se réfèrent à tel ou tel d'entre nous : elles ont un être propre qui échappe à chacun et lui résiste. C'est dire encore que je vois le monde et ma vie selon la manière dont les Autres les qualifient, les interprètent.
C'est dans le cadre de la "covivance" que s'ouvrent les deux directions de la vie interindividuelle et de la société : "Le social apparaît, non comme on l'a cru jusqu'ici en s'opposant à l'individuel, mais par contraste avec l'interindividuel". Et c'est l'usage qui révèle la spécificité du social comme habitude collective échappant à mes prises et s'imposant à moi. Le social n'est pas ma vie mais une insociale. Ainsi tout le social est une machine à conserver, en la fossilisant sous forme d'institutions, de la vie humaine personnelle : des individus créent une manière de faire nouvelle qui devient un usage, destiné à tomber plus tard en désuétude. Les dimensions sociales déterminantes apparaissent dans la langue et l'opinion publique (le "dire" des gens), la "vigueur" des usages, des institutions et des lois, dans le "pouvoir public", enfin. Tout le social est donc porteur des caractères que les philosophes n'attribuent communément qu'au droit : il ne dépend pas de l'adhésion individuelle et il sert d'instance supérieure à laquelle chacun peut recourir. Comme l'écrit Ortega :
"Les mots n'ont pas une étymologie parce qu'ils sont des mots mais parce qu'ils sont des usages. Mais cela nous oblige à reconnaître et à déclarer que l'homme est essentiellement, de par son inexorable destin de membre d'une société, l'animal étymologique Ainsi l'histoire entière ne serait qu'une immense étymologie, le grandiose système des étymologies. Et c'est pourquoi l'histoire existe, et c'est pour cela que l'homme a besoin d'elle, parce qu'elle est l'unique discipline qui peut découvrir le sens de ce que l'homme fait et partant de ce qu'il est".
Voyons donc comment il peut y avoir une connaissance du passé humain.
2 : " Ce fut une erreur incalculable que de soutenir que la vie, laissée à elle-même, tend à l'égoïsme alors qu'elle est, dans sa racine et dans son essence, altruiste. " vie est le fait cosmique de l'altruisme et elle n'existe que comme perpétuelle émigration du Moi vital en direction de l'Autre." (Le thème de notre temps, chapitre VIII).
II/ Le fondement de la connaissance historique
| C'est dans un prologue à la traduction espagnole des Leçons sur la philosophie de l'Histoire de Hegel qu'Ortega aborde explicitement le thème de la science historique et du devenir historique (19 2 8). La science de l'histoire, qu'il dénomme alors historiologie, doit à ses yeux se définir en se séparant à la fois de l'histoire des historiens et de l'histoire des philosophes. A) L'Historiologie a) L'histoire des historiens L'histoire n'a pas ses classiques : la lecture de tous les historiens laisse dans la plus grande insatisfaction. Un penseur n'est pas classique par les solutions qu'il apporte aux problèmes abordés et qui sont destinées à être dépassées, un jour ou l'autre. Mais ce sont les problèmes qui sont éternels et celui-là seul peut aspirer à la gloire de la postérité qui s'est réellement mesuré avec eux. Et c'est cette plongée jusqu'aux racines mêmes de la réalité qui caractérise les penseurs classiques. Nous pouvons donc présumer que les historiens n'ont jamais essayé de comprendre l'histoire. Après Léopold Ranke (1795-1886), tous les historiens sont allés répétant que la mission de l'histoire est seulement de dire comment les choses se sont effectivement passées. La science historique se réduirait, dans ces conditions, à la critique des faits et des documents.
"Toute science de la réalité - et l'Histoire en est une - se compose de ces quatre éléments :
La proportion dans laquelle ces divers éléments ou instruments interviennent dans la science dépend de sa physiologie particulière, et celle-ci, à son tour, de la texture ontologique propre à chaque forme générale de la réalité".
|
b) L'histoire des philosophes.
Déterminer l'a priori historique, ce n'est pas pour autant tomber dans le dogmatisme des philosophies de l'histoire. La tentative de Hegel pour injecter le formalisme de sa logique dans le cours de l'histoire a suscité durant le XIXe siècle une série de conceptions de l'histoire qui convergent toutes en ce qu'elles consistent à choisir une classe de faits privilégiés dont on fait découler tout le reste. Ainsi pour Marx, le facteur déterminant dans l'histoire est, en dernière instance, la production et la reproduction de la vie réelle. Le droit, la politique, l'idéologie ne sont que des effets de la situation économique de base. Dans son Histoire de l'art de la guerre, Delbruck (1848-1929) présente une théorie selon laquelle ce serait les procédés d'armement qui détermineraient l'évolution historique. Mais ce genre d'explication présente l'inconvénient de ne dévoiler la réalité historique que très partiellement : il s'agit d'une systématisation imposée arbitrairement au cours de l'histoire par l'imagination de l'historien. La tâche de l'histoire n'est pas d'inventer une forme dans laquelle viendra se mouler, tant bien que mal, la réalité des faits historiques, mais bien de dégager de ceux-ci la structure particulière qui en soit la raison intrinsèque.
"Tout être possède sa Propre forme avant que la pensée ne le pense. Certes, la pensée possède également la sienne, en tant qu'elle est une réalité parmi les réalités. Mais la mission de l'intellect n'est pas de projeter sa forme sur le chaos des faits recueillis mais d'effectuer précisément le contraire. La caractéristique de la Pensée, sa forme constitutive consiste à adopter la forme des objets, à faire de ceux-ci son principe et sa norme. À rigoureusement parler, il n'y a pas une pensée formelle, il n'y a pas une logique qui fasse abstraction d'un objet déterminé de la pensée. (..) Il y a, en fait, autant de logiques qu'il y a de régions d'objets. En conséquence, c'est la matière ou le thème de la pensée qui, du même coup, se constitue en norme ou principe de la pensée. En somme, nous pensons avec les choses".
Penser, c'est donc comprendre les choses dans leur plénitude : non seulement prendre des vues partielles sur elles, mais appréhender leur être même. Vouloir trouver la raison de l'histoire dans une raison étrangère à l'histoire, c'est évidemment laisser échapper sa réalité même. On comprend que des esprits soucieux de serrer les choses de près aient conclu à une irrationalité totale de l'histoire plutôt que de s'en remettre à un dogmatisme unilatéral de type idéaliste ou matérialiste.
Ce que se propose l'historiologie, c'est donc de dégager la substance intime et concrète de l'histoire, son logos. Et pour ce faire, il faut commencer par situer l'historicité par rapport à la réalité radicale qu'est la vie de chacun.
c) La dimension historique de la vie humaine.
Il faut en revenir à la réalité radicale qu'est la vie de chacun pour lui-même. Cette vie est ouverte aux autres sur le mode de la coexistence, distincte de l'inclusion qui est le mode d'ouverture aux choses n'impliquant pas la réciprocité. La coexistence (convivencia) se partage en coexistence interindividuelle et coexistence collective. La coexistence interindividuelle est une première transcendance par rapport à l'immédiat et au " psychologique ". Les formes d'interaction entre deux individus (amitié, amour, haine, lutte, compromis) sont des phénomènes bipolaires dans lesquels deux séries de phénomènes psychiques constituent un phénomène ultra-psychique. Le complexe formé de deux vies humaines vit de sa vie propre, selon des lois particulières, avec une structure originale, et il se déploie suivant un processus qui oriente ma vie et celle de mon prochain. Mais cette vie interindividuelle, y compris chacune des portions individuelles qu'elle renferme, trouve également devant elle un troisième personnage : la vie anonyme --ni individuelle ni interindividuelle-, strictement collective, qui enveloppe les individus et exerce sur eux des pressions de tous ordres.
Ainsi, avant d'être des sujets psychologiques, nous sommes des sujets sociologiques. Car si chacun s'apparaît à lui-même comme un être indépendant parmi d'autres composant avec lui une société, en réalité c'est la société qui, en-deçà des individualités, constitue le fond d'où émerge chaque vie. L'esprit subjectif est porté par l'esprit objectif, pour employer le langage de Hegel. Mais la vie sociale, à son tour, comporte toujours une incomplétude : le caractère de changement incessant qui se manifeste dès le niveau de la vie individuelle se trouve encore plus accentué quand il s'agit de la vie sociale.
"À chaque instant, celle-ci est quelque chose qui vient d'un passé, c'est-à-dire d'une autre vie sociale révolue et se dirige vers une vie sociale future. Le simple fait, pour tout aujourd'hui social de se trouver structuré par l'articulation de trois générations révèle que la vie sociale présente n'est qu'une section d'un tout vital des plus amples aux limites indéfinies vers le passé et l'avenir, et qui s'enfonce et se perd dans ces deux directions. C'est là, sensu stricto, la vie ou la réalité historique".
Ma vie et la vie historique sont ainsi les deux pôles de toute action et de toute pensée. Et d'emblée leur différence fondamentale apparaît : tandis qu'il est essentiel à la vie individuelle d'être circonscrite par la naissance et la mort, la vie historique, en revanche, ignore toute conclusion ultime et ses mouvements ne sont pas orientés par l'anticipation d'un terme fatidique. Il convient donc de déterminer à présent comment cet horizon indépassable et indéfini peut être objet de science.
B) Un galiléisme de l'histoire
a) Comment l'histoire peut-elle être une science?
C'est dans un cours professé en 1933, En torno a Galileo, qu'Ortega pose le problème de la connaissance historique en revendiquant pour l'histoire un statut identique à celui que Galilée, avec Descartes, avait su donner à la nuova scienza :
"La science est interprétation des faits. Par eux-mêmes, ils ne nous livrent pas la réalité ; au contraire, ils l'occultent, c'est-à-dire qu'ils nous posent le problème de la réalité. S'il n'y avait pas de faits, il n'y aurait pas de problèmes, il n, aurait rien d'énigmatique, rien de caché se donnant précisément a désocculter, à découvrir. Le mot avec lequel les Grecs désignaient la vérité est alétheia, qui veut dire que l'on opère un dévoilement, que l'on retire le voile qui cache et recouvre quelque chose. "
Aussi bien l'innovation de Galilée ne fut-elle pas -l'expérimentation, mais l'adjonction au pur empirisme, qui observe le fait naturel ou le phénomène provoqué, d'une discipline ultra-empirique : l'analyse de la nature. La physique est précisément cette articulation de l'analyse sur l'observation. L'expérimentation n'est qu'une confirmation, elle implique l'analyse et son rôle se borne à vérifier la correspondance de l'idée et de l'expérience, du théorique et du phénoménal. C'est une erreur de voir la valeur et l'essence de la physique dans la seule expérimentation. La science est l'œuvre d'un Newton ou d'un Einstein et elle ne se réduit pas à un amoncellement d'observations. Les faits constituent ce qui s'offre à la science : elle commence au-delà.
En abordant la multitude des vies humaines, l'histoire se trouve dans la même situation que Galilée devant les corps en mouvement. Le nombre et la diversité des mouvements sont tels que nous n'apprendrons rien du mouvement en les observant. Si le mouvement n'a pas une structure essentielle et toujours identique dont les mouvements singuliers des corps sont de simples variétés et modalités, la physique est impossible. C'est pourquoi Galilée n'a d'autre recours que de commencer par construire le schéma de tout mouvement. Dans les mouvements qu'il observera ensuite, ce schéma devra toujours se reproduire ; et c'est grâce à ce schéma qu'il pourra dire en quoi et pourquoi les mouvements, effectifs se différencient les uns des autres. Il est nécessaire que dans la fumée qui monte de la cheminée et dans la pierre qui tombe de la tour, une même réalité existe sous des aspects différents ; Il faut que la fumée monte précisément pour les mêmes raisons qui font que la pierre tombe. Ainsi l'histoire n'est pas possible si la foule des vies humaines, en dépit de leur extrême diversité, ne recèle pas une structure essentielle et toujours identique.
b) Quelle est la substance de l'histoire ?
Pour répondre à cette question, il faut régresser jusqu'à la structure de la vie humaine qui est la réalité radicale où s'enracinent toutes les autres réalités. Notre vie est constituée par deux dimensions inséparables que l'analyse doit disjoindre : d'une part, vivre c'est être en situation, se trouver dans une circonstance déterminée et n'avoir d'autre recours que de s'expliquer avec elle ; et c'est de là que procède, d'autre part, la nécessité de découvrir ce qu'est cette circonstance. Ainsi la vie est indissolublement problème et tentative de résolution du problème. Mais dire de la vie humaine qu'elle est interprétation d'elle-même ne signifie pas que chacun en particulier ait à effectuer l'effort original d'interpréter l'univers : la société dans laquelle nous venons au monde détient déjà un répertoire d'idées, de croyances en vigueur. À cet appareillage intellectuel s'ajoute d'ailleurs la technique avec laquelle chaque société assure son emprise sur son milieu (4), idéologie et technique s'influençant réciproquement.
Ainsi Ortega retrouve-t-il mais pour les abandonner aussitôt les définitions traditionnelles de l'homme comme homo sapiens et homo faber. Certes l'homme pense : mais cela ne le conduit à aucun savoir définitif. Penser est pour lui une tâche - il a à savoir à quoi s'en tenir sur le monde qui l'environne. Et s'il est artisan, ce n'est pas seulement de son outillage matériel mais de son être même : il lui faut s'inventer et se donner à lui-même sa propre vie.
"Avec plus ou moins de dynamisme, d'originalité et d'énergie, l'homme constamment engendre, fabrique le monde, monde ou univers qui n'est que le schéma où l'interprétation qu'il met en œuvre pour assurer sa propre vie. Nous dirons donc que le monde est l'instrument par excellence que l'homme produit, et cette production est une seule et même chose avec sa vie, avec son être. L'homme est un fabricant né d'univers.
Et voilà pourquoi il y a histoire : parce qu'il y a une variation continuelle des vies humaines. ".
L'objet de l'histoire se trouve ainsi formellement circonscrit comme étude des formes successives qu'a revêtues la vie humaine. Mais il faut bien se garder d'entendre cette expression dans un sens psychologiste ou subjectiviste. La vie doit être distinguée de l'homme, c'est-à-dire du sujet qui vit : la vie consiste dans le drame du sujet qui se trouve dans la nécessité d'affronter le monde dans lequel il est "embarqué" comme disait Pascal. L'histoire ne retrace pas la psychologie des hommes ; elle reconstruit la structure du drame qui se joue entre l'homme et le monde. Les différences subjectives sont accessoires et ne font qu'apporter quelques légères modifications au schéma d'un drame commun à ceux qui appartiennent à un même monde. La question fondamentale pour l'historien n'est pas de se demander comment ont changé les êtres humains, mais bien comment a varié la structure objective de la vie.
"Chacun de nous se trouve aujourd'hui engagé dans un système de problèmes, de dangers, de facilités et de difficultés, de possibilités et d'impossibilités qui ne se confondent pas avec lui, mais qui au contraire constituent sa situation, ce avec quoi il doit compter, sa vie consistant précisément à manœuvrer et à affronter ce système. S'il était né cent ans avant, tout en possédant le même caractère et les mêmes aptitudes, le drame de sa vie aurait été tout autre."
4 : On peut voir là-dessus, d'Ortega, Méditation de la technique (1933)
c) Comment analyser le cours de l'histoire?
C'est dès 1923, dans El tema de nuestro tiempo, qu'apparaît le concept de génération à partir duquel Ortega élaborera la méthode des générations dans En torno a Galileo (1933).
Le concept de génération a souvent été employé par les historiens de la littérature et de l'art pour situer les variations du goût dans le cours des temps. Ortega l'emploie dans un sens plus méthodique, plus général et plus profond ; pour lui, ce sont les générations qui font l'histoire, autrement dit, le sujet de l'histoire, c'est la génération. Chaque génération prise en elle-même constitue une unité de pensées de sentiments, de croyances, d'aspirations et d'entreprises ; elle a sa "sensibilité vitale" propre qui déterminera tous les caractères particuliers à une époque. La génération est conçue comme l'élément premier de l'histoire, le chaînon de la grande chaîne, "le gond sur lequel l'histoire exécute ses mouvements", dit Ortega. Le fait le plus élémentaire de la vie humaine, fait-il remarquer, c'est que certains hommes meurent et que d'autres naissent, que les vies se succèdent. Toute vie humaine est donc intercalée entre des vies qui la précèdent et d'autres qui la suivent : là est le fondement des changements qui affectent la structure du monde, la cause première du devenir. La finitude humaine tient en effet au temps qui enferme chaque vie entre la naissance et la mort : l'âge consiste pour chaque homme à se trouver toujours en un certain point du temps qui lui est imparti, au commencement, ou dans la première moitié, au beau milieu, ou en direction de la fin, c'est-à-dire dans l'enfance, dans la jeunesse, dans la maturité ou dans la vieillesse. Mais cela implique que toute actualité historique, tout "aujourd'hui" comporte en réalité trois temps distincts, trois "aujourd'hui" différents, ou, autrement dit, que le, présent est riche de trois dimensions vitales qui coexistent bon gré mal gré en lui, nouées les unes aux autres et condamnées, du fait même de leurs différences, à être en lutte les unes contre les autres. "Aujourd'hui", c'est pour les uns avoir 20 ans, pour les autres, 40 ou 60 ans.
Le concept ortéguien de génération n'apparaît donc qu'à la faveur d'une distinction radicale séparant la contemporanéité (sont contemporains tous ceux qui vivent dans un même temps, une même atmosphère, un même monde) et la coétanéité (le fait d avoir le même âge). Tous ceux qui appartiennent à une même époque n'ont pas le même âge : c'est pourquoi ils ne s'entendent pas entre eux à propos du monde dans lequel ils coexistent et qu'ils contribuent à former de différentes façons. Si tous les contemporains avaient le même âge, l'histoire arrêterait son cours ; c'est grâce à la différence des âges que l'histoire est changement, devenir incessant. Il ne faut donc pas entendre la suite des générations comme une succession généalogique de classes d'âges différentes (fils, pères, grands-pères), mais comme l'empiètement et le conflit des différentes classes d'âges au sein d'un même monde en train de changer du fait même de cet affrontement. Une génération est donc l'ensemble de ceux qui ont le même âge à l'intérieur d'un cercle donné de coexistence. Le concept de génération ne comprend fondamentalement par conséquent que deux éléments : avoir le même âge et avoir un contact vital quelconque. Si ce concept exprime l'articulation effective de l'histoire, il nous livre, par là-même, la méthode fondamentale pour l'investigation historique.
"Dans ce que l'on appelle "aujourd'hui", dans tout "aujourd'hui" plusieurs générations vont articulées ensemble, et les relations qui s'établissent entre elles, selon la diversité des conditions propres aux différents âges, représentent le système dynamique d'attractions et de répulsions, de concordance et de discordance qui constitue à chaque instant la réalité de la vie historique. L'idée des générations, transformée en méthode d'investigation historique, ne consiste qu'à projeter cette structure sur tout le passé. Toute autre démarche reviendrait à renoncer à découvrir la réalité authentique de la vie humaine en chaque temps -ce qui est la mission de l'histoire. La méthode des générations nous permet de voir cette vie du dedans, dans son actualité. L'histoire consiste à convertir virtuellement en présent ce qui est déjà passé. C'est pour cela -et non seulement dans un sens métaphorique que l'histoire est une résurrection du passé. Et comme on ne peut vivre qu'actuellement et présentement, nous ne pouvons que nous transporter dans l'actualité et le présent d'autrefois, pour les regarder non pas du dehors, comme déjà révolus, mais comme en train de se faire."
La méthode des générations fait ainsi apparaître la réalité historique comme étant constituée à chaque instant par la vie des hommes qui ont entre 30 et 60 ans. Mais ce qui est décisif, selon Ortega, c'est de concevoir que ces contemporains qui n'ont pas le même âge se divisent en deux générations. La réalité historique est faite par des hommes qui se situent dans deux étapes différentes de la vie : de 30 à 45 ans, c'est une étape de gestation ou de création et de polémique -, de 45 à 60 ans, c'est une étape de domination et de commandement. Ceux-ci vivent dans le monde qu'ils se sont construit ; ceux-là sont en train d'édifier leur monde. Il n'y a pas deux tâches vitales, deux structures de la vie plus différentes. Il y a donc toujours deux générations qui prennent en main en même temps la réalité historique et il semblerait que celle-ci procède par vagues successives de quinze ans, "quinze ans de gestation et quinze ans de gestion", dit Ortega. Et de ce point de vue, il importe au plus haut point pour l'historien de pouvoir déterminer les dates qui délimitent chaque génération. Ortega propose de distinguer comme " génération décisive " la génération qui sans être encore créatrice n'est plus pour autant héritière. Par exemple, pour l'Age Moderne, dans l'ordre de la philosophie et des sciences, la période qui s'étend de 1600 à 1650 renferme cette génération décisive. Pour l'y situer exactement, il suffit de considérer Descartes comme "l'éponyme de la génération décisive". Dès lors, tout s'ensuit mathématiquement. C'est en 1626 que Descartes a trente ans : si nous remontons jusqu'en 1611, nous trouvons la génération de Hobbes et Grotius ; puis jusqu'à 1596, nous rencontrons celle de Galilée, Kepler, Bacon ; jusqu'à 1581, nous trouvons Giordano Bruno, Tycho Brahe et Cervantes.
Par cet exemple, Ortega veut faire ressortir le caractère objectif du concept de génération : c'est le devenir lui-même qui se produit comme série effective de générations. Est-il possible de déterminer plus précisément cette production de l'histoire ? C'est ce qu'il nous reste à voir en envisageant à présent comment, au sein de l'histoire, la crise se différencie du changement.
III/ Histoire, changement et crises
| Pierre-Henri Simon remarquait dans son essai L'Esprit et l'Histoire (5) que toute conception de l'histoire doit toujours se prononcer sur deux questions : "L'esprit de l'homme est-il le principal moteur des événements ou, au contraire, ceux-ci suivent-ils un cours naturel et déterminé qui provoque les attitudes de la conscience? C'est l'a première question. Fatal ou libre, le sens de l'histoire est-il rassurant pour l'homme, celui-ci doit-il désespérer devant la succession séculaire des malheurs et des violences ou, au contraire, peut-il croire, sinon à une finalité nécessaire d'ordre et de paix, du moins à une progression normale vers une situation meilleure, à un salut possible de l'espèce ? C'est la seconde question." Si nous appliquons ce schéma à la philosophie d'Ortega, nous aurons à préciser quel est, pour lui, le phénomène primitif décidant du cours de l'histoire, et quelle représentation du progrès il nous propose. A) L'histoire est un système a) Quel est le moteur de l'histoire ? C'est en rapportant l'histoire à la réalité radicale que L'histoire comme système (19357répond à cette première question. La caractéristique la plus banale et en même temps la plus importante de la vie humaine est qu'il faut toujours faire quelque chose pour se maintenir dans l'existence : la vie est à faire, la vie est affairement, répète Ortega en jouant sur les mots ("La vida es quehacer"). Mais pour décider de ce qu'on va faire, il"faut avoir des convictions sur le monde alentour.
Le diagnostic d'une existence humaine -d'un homme, d'un peuple, d'une époque doit commencer par le répertoire des convictions. Elles sont le sol de notre vie. "
Tout terme historique, pour être précis, doit être
Si toute vie humaine surgit dans une société munie à la fois d'une idéologie et d'une technique, on voit comment pour Ortega, l'idéologie est le facteur déterminant. b) Comment faut-il concevoir le progrès ? Si l'histoire est pour l'homme une thésaurisation d'être, il n'est pourtant pas possible d'assurer a priori que l'humanité s'achemine vers un mieux-être. C'est précisément parce que le changement est consubstantiel à l'homme qu'on ne peut soutenir le déterminisme absolu de l'histoire. Ortega écrit à ce sujet " je pense que toute vie et partant la vie historique, est composée de purs instants dont chacun est relativement indéterminé par rapport au précédent, de sorte que la réalité vacille en lui, piétine sur place et hésite à se décider pour l'une ou l'autre des différentes possibilités" (La révolte des masses). Il n'y a aucune raison non plus de nier la réalité du progrès, mais il faut en corriger la notion qui nous le ferait considérer comme une négation du passé : si le cours de l'histoire est irréversible, c'est parce que l'être présent de l'homme inclut toujours son passé : "nier le passé est absurde et illusoire, car le passé c'est le naturel de l'homme qui revient au galop." Qu'est-ce donc que le progrès pour Ortega ? "Les gens frivoles pensent que le progrès humain consiste en un accroissement quantitatif des choses et des idées. Non. Le véritable progrès, c'est l'intensité de plus en plus forte avec laquelle nous percevons une demi-douzaine de mystères essentiels qui, dans la pénombre de l'histoire, palpitent, vivants comme des cœurs" (El Espectador). C'est pourquoi l'idée d'un progrès inéluctable est non seulement erronée mais encore pernicieuse car elle nous dissimule l'insécurité radicale qui fait le fond de toute vie. C'est du "sentiment tragique de la vie", comme disait Unamuno, que jaillit toute création, et l'idéologie du progrès risque d'agir comme un opium. Aussi peut-on inscrire au compte du progrès l'apparition du "sens historique" à travers le XIXe siècle européen : c'est là véritablement un nouvel organe avec lequel l'homme perçoit l'homme. C'est par lui que s'aiguise en nous la conscience de la fragilité des acquisitions humaines de tous ordres : c'est grâce à lui que "nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles."
5 : Armand Colin, 1954. 6 : Traduction française en 1946, chez Stock. |
B) Changement et crise
a) Changement dans le monde et changement du monde
Reprenant à son compte la célèbre distinction saint-simonienne entre les époques organiques et les époques critiques, Ortega oppose aux siècles d'or, qui correspondent à ce qu'on appelle en général les âges classiques, les périodes de crise, qu'il différencie par ailleurs des périodes normales.' Le siècle d'or, que ce soit celui de saint Thomas ou de Descartes, est une époque pendant laquelle l'homme sait à quoi s'en tenir sur les problèmes essentiels qui concernent sa vie et parvient à les résoudre. Ce qui caractérise les périodes normales, c'est que le monde qu'elles ont hérité du siècle d'or qui les a précédées ne subit que des modifications de détail tout en perdant progressivement de sa solidité. En revanche, dans les périodes de crise, l'ordre ancien s'écroule, l'homme n'a plus que des convictions négatives, il sombre dans le désarroi.
Il y a donc deux formes de changement historique : un changement qui survient dans le monde de l'homme, et un changement du monde lui-même. Ainsi l'innovation intellectuelle représentée pas la révolution copernicienne ne détermine initialement aucun changement : le livre De revolutionnibus orbium coelestium passe inaperçu en 1543, et c'est seulement avec La cena delle ceneri de Galilée, en 1584, que cette nouvelle conception bouleverse l'image du monde. C'est qu'entre temps les sciences ont été valorisées: après Vives, Servet, Viete, G. Bruno la foi dans la science est devenue possible, Galilée et Kepler trouveront une audience. Au contraire, la situation est toute différente quand le monde change : vers 1600, par exemple, l'homme européen opère un virage radical au cours duquel une nouvelle forme de vie, un homme nouveau, l'homme moderne, surgissent. Au Moyen-Age, l'horizon vital est distinct de la perspective de la
science. A l'époque moderne, elles sont confondues : cette fusion, c'est en toute rigueur, l'Age moderne, représenté par Galilée et Descartes. Et c'est l'époque traditionnellement dénommée Renaissance qui est la période de crise précédant la véritable renaissance de l'homme européen, l'avènement de la modernité. Aussi a-t-elle été avant tout un temps de confusion.
"La confusion est inhérente à toute époque de crise. Car, en définitive, ce qu'on appelle "crise" n'est que le fait pour l'homme de passer d'une existence attachée à certaines choses et appuyée sur elles à une existence attachée à d'autres choses sur lesquelles elle s'appuie. Le passage consiste donc en deux rudes opérations : d'une part, se détacher de la source où s'alimentait la vie -n'oublions pas notre vie vit toujours grâce a une interprétation de l'Univers d'autre part ' se mettre en mesure de s'attacher à une nouvelle source de vie, c'est-à-dire s'accoutumer progressivement à une autre perspective vitale, s'habituer à considérer d'autres choses et à s'en remettre à elles. ( .. ) Et ce n'est pas parce que le fait s'est répété plus d'une fois dans l'histoire que notre surprise s'atténuera en voyant l'homme contraint périodiquement de secouer sa propre culture et de s'en dépouiller."
La question qui se pose est donc de savoir pour quelles raisons une culture cesse de satisfaire une génération, pourquoi un système de croyances ne peut être définitif. Si le moteur de l'histoire est le changement idéologique, pourquoi y a-t-il des crises?
b) Tradition raison et mysticisme
Voici, brièvement résumée, la réponse d'Ortega. La culture n'est que l'interprétation donnée par l'homme à sa vie, l'ensemble de solutions plus ou moins satisfaisantes qu'il invente pour parer aux problèmes qui se posent à lui. Mais la création d'un répertoire de principes et de normes culturelles comporte un inconvénient constitutif et irrémédiable : précisément parce que la culture est déjà là, les générations postérieures à sa création n'ont pas à la créer, mais seulement à la recevoir et à la développer. Celui qui reçoit une idée tend à s'épargner l'effort de la repenser, de la recréer en lui-même. Il ne mettra donc pas les choses en question, en sorte que les générations héritières d'une culture s'habituent progressivement à ne pas prendre contact avec les problèmes fondamentaux et que l'homme y vit sans coïncider avec lui-même, séparé de lui-même par une culture qui lui est devenue étrangère.
"Il s'agit donc d'un processus inexorable. La culture, le produit le plus pur de l'authenticité vitale, puisqu'il procède de ce que l'homme sent avec une angoisse terrible et un ardent enthousiasme les nécessités inéluctables dont sa vie est faite, finit par être la falsification de sa vie. Son moi authentique est étouffé par son moi "cultivé", conventionnel, social ( .. ) Or l'homme trop "cultivé" et "socialisé", qui vit d'une culture déjà fausse, ressent un besoin impérieux d'une... autre culture, c'est-à-dire d'une culture authentique. Mais celle-ci ne saurait prendre son essor qu'à partir du fond ingénu et dépouillé du moi proprement personnel. Il lui faut donc reprendre contact avec lui-même. (..) De là viennent ces périodes de "retour à la nature", c'est-à-dire à ce qu'il y a en l'homme d'origine1, par opposition à ce qu'il y a en lui de cultivé ou de culturel. Par exemple, la Renaissance, par exemple Rousseau et le Romantisme et... toute notre époque. "
Tel est le paradoxe déjà remarqué par Georg Simmel (1858-1918) : la vie ne peut se passer de la culture et pourtant la culture tue la vie, "La conscience de la sécurité tue la vie", dit Ortega. C'est pourquoi à chaque système de croyances fait suite un nouveau système de croyances qui ne peut en aucune façon être une répétition pure et simple.
Mais cette succession semble s'effectuer selon un cycle régulier que décrit El Ocaso de las Revoluciones (1923). Ortega commence par noter que ce qui est le moins important dans les révolutions, c'est la violence. Au niveau des grands moments historiques connus -monde grec, monde romain, monde européen, on découvre non des cassures, des tournants brusques, mais des ères révolutionnaires. C'est que la révolution est d'abord un état d'esprit.
"On a dit cent fois après Danton que la révolution se faisait dans les têtes avant de commencer dans les rues. Si l'on avait bien analysé ce qui est impliqué dans cette expression, on aurait découvert la physiologie des révolutions.
Toutes les révolutions authentiques supposent, en effet, une disposition caractéristique des esprits, des cerveaux. Pour bien comprendre en quoi elle consiste, il faut faire glisser le regard sur les grands organismes historiques qui ont complètement achevé leur cycle. On remarque alors que dans chacune de ces grandes collectivités, l'homme est passé par trois situations spirituelles distinctes, ou, autrement dit, que sa vie mentale a gravité successivement autour de trois centres différents.
D'un état d'esprit traditionnel, il passe à un état d'esprit rationaliste, et de celui-ci à un régime de mysticisme. Ce sont là, pour ainsi dire, trois formes différentes du mécanisme psychique, trois manières distinctes de fonctionner pour l '"appareil mental de l'homme. "
C'est quand un peuple est jeune que le passé a sur lui le plus d'emprise tel fut le cas, par exemple, pour le Moyen-Age. Plus complexe, plus riche et plus délicate que l'âme primitive, l'âme médiévale fonctionne toutefois selon le même principe : pour rendre compte d'un fait, pour identifier un être, on ne cherche pas une explication qui satisfasse l'intelligence on a recours à un récit, un mythe ou une autorité qui fassent la lumière. Ce sont là les époques où règne le droit coutumier et où se constituent les nations : le corps social s'est développé, et le moment est venu de dépenser les forces accumulées. A l'expansion extérieure de la nation va correspondre à l'intérieur l'apparition de l'individualisme. Dès lors, la raison va progressivement se substituer à la tradition comme principe de pensée et d'action. C'est ce que Descartes appellera "bon sens" et Kant "raison pure ". La raison pure n'est pas l'entendement mais une manière extrême pour lui d'opérer. La raison pure est l'entendement délesté de son rapport à l'expérience, c'est-à-dire laissé à lui-même et ambitionnant de régenter la pensée et de transformer le monde. Si la mathématique est le produit par excellence de la raison pure, l'esprit révolutionnaire en est une autre manifestation. Les révolutions n'ont donc pas leur origine dans l'oppression des classes inférieures par ceux qui les dominent ni dans une plus grande sensibilité à l'injustice, mais dans une transformation de l'intelligence. Et lorsque la phase rationaliste aura épuisé ses possibilités, elle cédera la place à une phase de mysticisme ou plus exactement de superstition.
"L âme traditionaliste est un mécanisme de confiance, car toute son activité consiste à s'appuyer sur la sagesse incontestée du passé. L'âme rationaliste rejette ces assises de la confiance avec la fierté d'une foi nouvelle: la foi dans l'énergie individuelle dont la raison est le moment suprême. Mais le rationalisme est une tentative excessive, il aspire à l'impossible. Le propos de remplacer la réalité par l'idée est admirable parce qu'il électrise à la façon d'une illusion, mais il est toujours condamné à l'échec. Une entreprise aussi démesurée laisse derrière elle l'histoire transformée en une aire de désillusion. Après la déroute dont il a souffert dans son audacieuse tentative idéaliste, l'homme reste complètement démoralisé. Il perd toute foi spontanée, il ne croit plus en aucune sorte de force claire et disciplinée : ni dans la tradition, ni dans la raison, ni dans la collectivité, ni dans l'individu. Ses ressorts vitaux se relâchent parce que ce sont en définitive les croyances que nous portons en nous qui les maintiennent tendus. Il n'a plus l'énergie suffisante pour conserver une attitude digne devant le mystère de la vie et devant l' univers. Physiquement et mentalement, il dégénère. Dans ces temps, la moisson humaine est épuisée, la nation se dépeuple. ( ... ) En bref, incapable de se suffire à lui-même, l'esprit cherche une planche de salut et attend, comme un chien battu, que quelqu'un le prenne sous sa protection. L'âme superstitieuse est en effet le chien en quête d'un maître. ( .. ) Le nom qui convient peut-être le mieux à l'esprit qui se fait jour à travers le déclin des révolutions, c'est celui d'esprit servile."
On voit comment la conception ortéguienne de l'histoire est solidaire de la théorie des croyances (qui distingue la foi vivante, la foi morte et le doute), ainsi que de la théorie de l'interprétation qui fait se succéder, dans la culture la superstition, le mythe et la science. Les unes et les autres concourent d'ailleurs à nous permettre de penser notre temps, puisque, selon notre auteur, "l'histoire est la science du présent le plus rigoureux et le plus actuel."
C) La crise au XXè siècle
C'est par La révolte des masses, livre publié en 1930, qu'Ortega se fit connaître du public européen, et notamment en France où la traduction parut en 1937, avec une "Préface pour le lecteur français" dans laquelle il écrit qu'il faut se reporter aux années 1926-1928 pour les premiers chapitres qui ont le plus vieilli. Le propos de l'œuvre est "de faire l'analyse du type humain dominant à notre époque."
a) La croissance de la vie
Ce qui frappe dès que nous nous penchons sur notre temps, c'est que brusquement la foule est devenue visible : elle est le personnage principal. Avant même de se demander si l'avènement des masses au pouvoir social s'est réalisé pour le meilleur ou pour le pire, il faut reconnaître que c'est là le fait le plus important de la vie européenne actuelle. La vie de l'homme moyen est constituée aujourd'hui en Europe, par l'ensemble des possibilités qui, autrefois, caractérisaient les minorités dominantes.
Une donnée statistique décisive complète ce tableau : du VIe siècle à 1800 -soit pendant douze siècles-, la population de l'Europe n'est jamais parvenue à dépasser 180 millions d'habitants ; or de 1800 à 1914 -seulement pendant un peu plus d'un siècle-, elle s'élève de 180 à 460 millions ! "Cet accroissement subit -écrit Ortega- signifie que d'énormes masses d'hommes ont été projetées dans l'histoire à un rythme si accéléré qu'il n'était guère facile de les saturer de la culture traditionnelle." Aussi l'homme actuel produit-il souvent l'effet d'un homme primitif surgi brusquement au milieu d'une vieille civilisation. C'est ce type humain qu'Ortega appelle « l'homme-masse ».
"Le mot ne désigne pas ici une classe sociale, mais une classe d'hommes, une manière d'être qui se manifeste aujourd'hui dans toutes les classes sociales, et qui est, par là même, représentative de notre temps, sur lequel elle domine et règne."
c) L'homme-masse
"Si l'on voulait donner l'équation psychologique du type humain qui domine aujourd'hui, il faudrait dire que les deux facteurs en sont l'hermétisme et l'indocilité. La démocratie libérale, l'expérience scientifique et l'industrialisation se sont conjuguées pour rendre possible ce monde nouveau où l'homme ne se sent limité dans aucune direction, où nulle restriction ne lui est imposée, mais où tous ses appétits sont sans cesse avivés et peuvent croître indéfiniment. Rien de plus significatif à cet égard que le caractère de l'intervention des masses : sous les traits du fascisme, en particulier, "apparaît pour la première fois en Europe un type d'homme qui ne veut ni donner de raisons ni même avoir raison, mais qui simplement se montre résolu à imposer ses opinions. "
L'ignorance historique de l'homme-masse et son indifférence au passé sont encore à interpréter dans le même sens. Faire corps avec le passé est un des moyens les plus sûrs de résoudre les problèmes de la civilisation : si le passé ne nous dit pas ce que nous devons faire, il nous montre du moins les chemins que nous ne pouvons plus emprunter. Et la conscience scientifique, l'esprit scientifique lui-même pâtissent de cet état de choses : le spécialiste, fait remarquer Ortega, connaît très bien son petit recoin d'univers, mais il ignore innocemment tout le reste. La science est un produit supervolatile qui exige un travail d'unification et de reconstruction incessant dont ne devient capable qu'un nombre de plus en plus restreint de têtes.
Mais ce qui est le plus révélateur de notre temps, c'est encore l'attitude de l'homme-masse face à l'Etat. Il le voit, l'admire, sait qu'il est là, assurant sa vie, mais il n'a pas conscience qu'il s'agit d'une création humaine devant répondre à des normes définies sous peine de dégénérer dangereusement. L' Etat est une technique d'ordre administratif et public : tant que la force sociale est supérieure à la force du pouvoir public, les révolutions sont possibles, mais si le pouvoir public se place au niveau du pouvoir social, l'étatisation de la vie, l'absorption de toute spontanéité sociale par l'Etat s'est effectuée. Tel est le processus paradoxal et tragique de ce qu'Ortega nomme étatisme et que nous désignons aujourd'hui par le mot totalitarisme : la société, pour mieux vivre, crée l'Etat, comme une technique ; puis l'Etat prédomine et la société doit commencer à vivre pour l'Etat. Les masses ne résistent pas à la tentation de tout obtenir, sans effort, sans lutte, de l'Etat. Aussi, selon Ortega, "l'étatisme est la forme supérieure que prennent la violence et l'action directe érigées en normes : derrière l'Etat, machine anonyme, et par son entremise, ce sont les masses qui agissent par elles-mêmes".
Nous sommes à présent en mesure d'esquisser le portrait de l'homme-masse.
"L'homme-masse est l'homme dont la vie est sans projets et s'en va à la dérive. C'est pourquoi il ne construit rien, bien que ses possibilités et ses pouvoirs soient énormes. (..) Dans une bonne ordonnance des choses publiques, la masse est ce qui n'agit pas par soi-même. Sa " mission " est de ne pas agir. Elle est venue au monde pour être dirigée, influencée, organisée, représentée -même quand le but proposé est qu'elle cesse d'être masse ou du moins aspire à ne plus l'être (…). Elle doit régler sa vie sur cette instance supérieure que constituent les minorités d'élite (... ). La masse, en voulant agir par elle-même, se révolte donc contre son propre destin. Or, c'est ce qu'elle fait aujourd'hui ; je puis donc parler de révolte des masses. Car la seule chose que l'on puisse en substance appeler véritablement révolte est celle qui consiste pour chacun à ne pas accepter son propre destin, à s'insurger contre soi-même."
d) La vraie question
Le fond du problème, c'est donc pour Ortega que "l'Europe est restée sans morale", en entendant par "morale" essentiellement "un sentiment de soumission à quelque chose, la conscience de servir et d'avoir des obligations. "
"Nous ne savons pas ce qui nous arrive, mais c'est là précisément ce qui nous arrive : ne pas savoir ce qui nous arrive. L'homme d'aujourd'hui commence à se trouver désorienté par rapport à lui-même, dépaysé, jeté dans une circonstance nouvelle, comme sur une terre inconnue. Telle est toujours la sensation vitale qui s'empare de lui dans les crises historiques : la sensation de se trouver sur la ligne de partage de deux formes de vie, de deux mondes, de deux époques."
La révolte effrénée des masses a son origine dans une démoralisation de l'Europe dont la cause principale est le déplacement du pouvoir que l'Europe exerçait autrefois sur le monde et sur elle-même. Les Européens, pense Ortega, ne savent pas vivre s'ils ne sont engagés dans une grande entreprise qui les unisse. La civilisation européenne ne remplit plus la vie de l'homme, elle ne le rend plus heureux, elle n'absorbe plus son activité. Pour la première fois depuis le XIXe siècle, il faut de nouveau refaire l'homme: l'art, la science, la politique et tout le reste doivent renaître.
"La crise actuelle procède de ce que la nouvelle "posture" adoptée en 1600, la "posture moderne", a épuisé toutes ses possibilités, elle est parvenue à ses confins ultimes, et par là-même elle a révélé ses propres limites, ses contradictions et ses insuffisances."
L'analyse de la crise du XXe siècle conduit ainsi au thème le plus constant de la pensée d'Ortega . la nécessité de relayer la raison pure, la raison physico-mathématique, par ce qu'il nomme la raison historique. Dès 1923, Le thème de nôtre temps déclare que " la raison pure doit céder son empire à la raison vitale. " Puis c'est le cours Au sujet de Galilée qui, en 1933, proclame que "l'histoire est la science suprême, la science de la réalité fondamentale, l'histoire et non la physique. " L'histoire comme système, en 1935, expose comment, aliéné par une culture qui lui est devenue étrangère, "l'homme, séparé de lui-même, se retrouve
lui-même comme réalité, comme histoire." Enfin, en 1941 encore, les Notes sur la Pensée soulignent que la réalité spécifiquement humaine, la vie de l'homme, a une consistance historique, en sorte que force nous est de "dénaturaliser" tous les concepts se rapportant au phénomène de la vie humaine dans son ensemble et de les soumettre à une "historicisation" radicale. "
L'homme a besoin d'une nouvelle révélation : il lui faut passer d'un système de croyances à un autre. Et Ortega pense que cette nouvelle révélation est la raison historique. La raison pure appliquée à la vie humaine et à la société a été la source de l'utopisme révolutionnaire : l'homme d'aujourd'hui traverse la désillusion qui en a été l'issue fatale. Il faut renoncer et à la raison pure et à l'esprit révolutionnaire, pour en venir à la raison historique.
"Jusqu'ici, l'histoire était le contraire de la raison. En Grèce, les termes d'histoire et de raison s'opposaient l'un à l'autre. C'est qu'en effet, jusqu'à présent, on s'est à peine préoccupé de chercher dans l'histoire sa substance rationnelle. Tout au plus s'est-on efforcé d'introduire - en elle une raison étrangère ( .. ). Mon dessein est strictement inverse. Il s'agit de trouver dans l'histoire même sa raison originale et autochtone. Il convient donc d'entendre dans toute sa vigueur l'expression de "raison historique". Non pas une raison extra-historique qui semble s'accomplir dans l'histoire, mais littéralement ce qui est advenu à l'homme."
IV/ Raison historique et raison dialectique
IV - RAISON HISTORIQUE ET RAISON DIALECTIQUE
Mais le propos de Sartre, remarque 0. Paz, était voué à l'échec:
La raison analytique, la raison physico-mathématique ne suffit plus, si tant est qu'elle ait jamais suffi. Bergson l'a soutenu aussi de son côté, et Husserl dans La Crise des sciences européennes. Mais la "raison historique" nous semble seulement témoigner de cet épuisement sans ouvrir vraiment une nouvelle voie, tout comme l'"intuition" bergsonienne, d'ailleurs, ou la "phénoménologie transcendantale". |
7: Corriente alterna, 1967; traduit en français sous le titre Courant alternatif, en 1972, chez Gallimard.
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES
|
I. OEUVRES DE JOSE ORTEGA Y GASSET
|




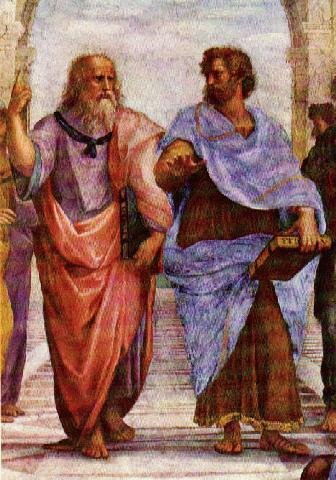
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire